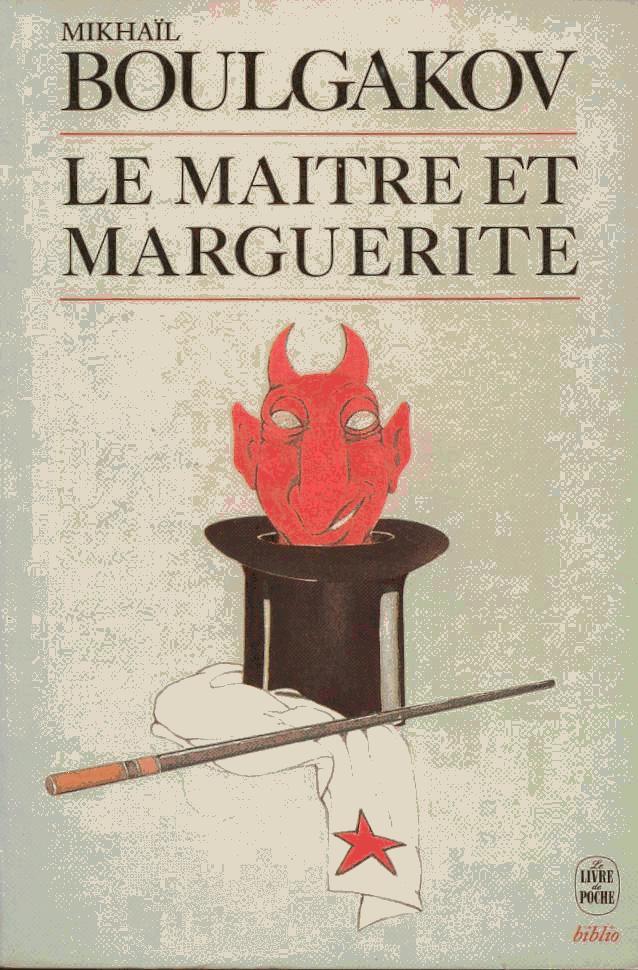Lire de la fiction rendrait intelligent, nous rappelle un article du Vif. Je reste un rien perplexe face à cette nouvelle, tant il me semblait évident que lire une oeuvre de qualité nécessitait une certaine intelligence émotionnelle hors de portée pour les lecteurs de Marc Lévy, Guillaume Musso, Paolo Coelho et autres Gavalda, nos écrivains d'hypermarchés dont la modernité réside dans la pauvreté affligeante du vocabulaire associée à des intrigues tellement stéréotypées que même le pire nanar cinématographique les surpasse par son mauvais goût inventif.
Lire Bartleby de Melville, un roman de Brautigan ou de Queneau, se plonger dans la science-fiction de l'âge d'or ou dans le roman noir contemporain nous délivre de nos petites compromissions avec notre quotidien. Nous pouvons ainsi nous évader des supposés raisons du petit jour pour nous lancer dans les flamboiements des hypothèses et y retrouver ce bien-être, cette impression de nous retrouver au centre de multiples réalités bien éloignées de ces littératures préfabriquées qui nous promettent une leçon de civisme ou de bonheur. Ne boudons jamais notre plaisir.
Rêver de l'énigme du Maître en croisant un quidam étrange, dans une Russie lointaine, se perdre dans le Montana de Crumley au milieu des terrils, épargner les oiseaux moqueurs en admirant les déplacements des pigeons : observer notre réalité de manière alternative, en laissant vagabonder notre esprit entre découverte et réminiscence, voilà toute la magie de la fiction, quand elle ne se cantonne pas à du nombrilisme mal maîtrisé ou à des représentations identitaires. Tout cela nous libère de ces petits résumés bien confortables auxquels nous nous conformons dans nos usages quotidiens : nous en deviendrions presque amoureux des cadeaux que notre réalité nous ménage, par hasard, au détour d'une illusion consentie, d'un bovarysme tranquille en compagnie de cette chère Emma.
Puisque nous sommes toujours au-delà de nous-mêmes, comme le disait à peu près Montaigne, pourquoi cédons-nous à ces représentations frelatées, issues du conformisme, que nous renvoient les médias de masse et la vie sociale ? La fiction, par son idéalisme qui ose tout, nous immunise face à ces fausses réalités dont les discours prétendument authentiques nous abreuvent d'informations forcément vulgaires et faussement nécessaires.
Alors, lisons pour vivre (Merci Gustave !) et plongeons dans ces fictions dont la réalité n'est qu'un médiocre substitut (Thank you Oscar !) pour retrouver le rythme de nos propres observations.